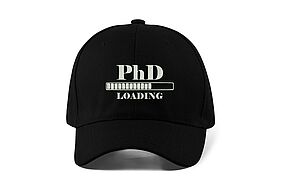Soutenance de thèse de Arthur Hochedé
SHERPAS Soutenance de thèse
Doctorante : Arthur Hochedé (Université d'Artois)
Titre de la thèse : Entre adoption et résistance quelles places pour les savoirs scientifiques dans le football professionnel ? Le cas de la prévention des blessures et de quantification de la charge de travail
Direction de thèse : Williams Nuytens (Unievrsité d'Arrtois), Grégory Dupont (Liverpool John Moore University) - Co-Encadrement : Nicolas Blondel (Université d'Artois)
Jury de thèse - Hélène Joncheray (INSEP, rapporteur), Matthieu Delalandre (Université d’Artois, examinateur), Claire Toulotte (Université Grenoble Alpes, rapporteur), Nathalie Carminatti (Université Paris Est Créteil, examinateur), Sébatien Ratel (Université Clermont Auvergne, examinateur)
Pour assister à la soutenance : le 8 décembre 2025 à 9h, Amphithéatre 3, Faculté des Sport et de l'Education Physique, Chemin du marquage, Liévin
Résumé : Cette thèse explore le régime de relations entre la recherche scientifique et le football professionnel, mettant en évidence l’asymétrie entre l’augmentation du volume des productions scientifiques et la limitation de leurs usages pratiques. Ce constat, loin d’être imputable à une seule partie, résulte de responsabilités partagées entre chercheurs et praticiens, marquées par des différences de temporalité, de langage et d’accessibilité aux savoirs. L’analyse des thématiques portant sur la prévention des blessures et la quantification de la charge de travail, deux domaines centraux dans la performance sportive, a permis d’illustrer ces tensions. Malgré l’accumulation des connaissances, certaines méthodes scientifiquement validées restent sous-utilisées sur le terrain, tandis que d’autres pratiques, parfois peu soutenues par des preuves solides, sont largement adoptées. Ce paradoxe témoigne des défis liés à l’intégration des savoirs scientifiques dans la réalité du haut niveau. Plusieurs facteurs expliquent ce décalage : la complexité des publications, leur coût, le manque de temps des praticiens, mais aussi la nécessité pour la recherche de mieux répondre aux besoins du terrain. La science en laboratoire et la pratique de terrain évoluent dans des mondes distincts, ce qui pose la question de la transmission et de l’appropriation des connaissances. Il ne s’agit pas seulement de produire des savoirs, mais de s’assurer de leur accessibilité et de leur applicabilité. Pour réduire cette fracture, le développement du rôle de « sport scientist » apparaît comme une solution clé. En assurant une médiation entre recherche et pratique, ce profil peut favoriser une intégration plus fluide des avancées scientifiques dans les routines d’entraînement. De même, des initiatives comme l’open access, la vulgarisation par des formats adaptés (infographies, podcasts, plateformes dédiées) ou encore le développement de départements de recherche au sein des clubs offrent des perspectives concrètes d’amélioration. Cette thèse, tout en adoptant une posture critique, ne vise ni à discréditer la recherche, ni à privilégier les praticiens. Elle défend l’idée d’une collaboration renforcée entre les deux sphères, en consolidant les passerelles entre savoirs académiques et savoirs issus du terrain. Dans un sport où les enjeux physiques, économiques et émotionnels sont considérables, la construction d’un dialogue plus efficace entre science et football professionnel représente une opportunité à saisir, tant pour la performance que pour la préservation de l’intégrité des joueurs.