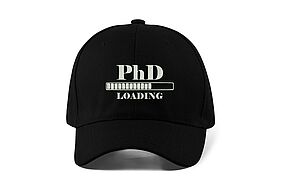Soutenance de thèse de Steven Crombecque
SHERPAS Soutenance de thèse
Doctorante : Steven Crombecque (Université d'Artois)
Titre de la thèse : Caractérisation des sujets lombalgiques chroniques, individualisation et optimisation des prises en charge pré et post-réhabilitation
Direction de thèse : Claire Toulotte (Unievrsité de Grenobles) - Co-Encadrement : Isabelle Caby (Université d'Artois)
Jury de thèse - Thierry Weissland (Université de Bordeaux, rapporteur), Emilie Simobeau (Université Polytechnique Hauts-De-France, rapporteur), Nicolas Besombes (Université Paris Cité, examinateur), Nicolas Olivier (Université de Lille, invité)
Pour assister à la soutenance : le 2 décembre 2025 à 13h, Rue Maurice Schuman, 62000 Arras, salle Salle des conférence
Résumé : Introduction : Face aux résultats inégaux des programmes de Restauration Fonctionnelle du Rachis (RFR) pour les patients lombalgiques chroniques, cette thèse vise à dépasser l'approche protocolaire traditionnelle pour développer une prise en soin personnalisée, articulant science universelle et singularité des parcours individuels. Méthodologie : Trois études complémentaires croisant approches quantitatives, intelligence artificielle et sociologie ont été menées. La première compare deux modalités : encadrement systématique (P2) versus autonomisation (P1). La deuxième évalue l'effet d'un pré-programme d'Activité Physique Adaptée de 12 semaines. La troisième utilise des modèles prédictifs pour identifier les profils de patients et variables prédictives de l'efficacité thérapeutique. Résultats : Le groupe autonomie (P1) montre une légère supériorité malgré une moindre orientation vers le reconditionnement physique. Le pré-programme améliore condition physique et qualité de vie des patients éloignés de l'activité physique, mais les bénéfices s'équilibrent à moyen terme. Les modèles prédictifs révèlent des relations non-linéaires complexes, avec identification de seuils critiques essentiels pour individualiser les soins. L'hétérogénéité des réponses justifie la distinction entre profils « répondants » et « non-répondants ». Conclusion : L'efficacité thérapeutique émerge de l'interaction complexe entre caractéristiques biopsychosociales, position par rapport aux seuils critiques et adéquation ressources/modalités thérapeutiques. L'autonomie révèle sa pertinence différenciée selon les profils. L'intégration de l'intelligence artificielle s'avère prometteuse pour personnaliser les soins. Cette méthodologie transdisciplinaire ouvre la voie à une médecine personnalisée, applicable à d'autres pathologies chroniques complexes.